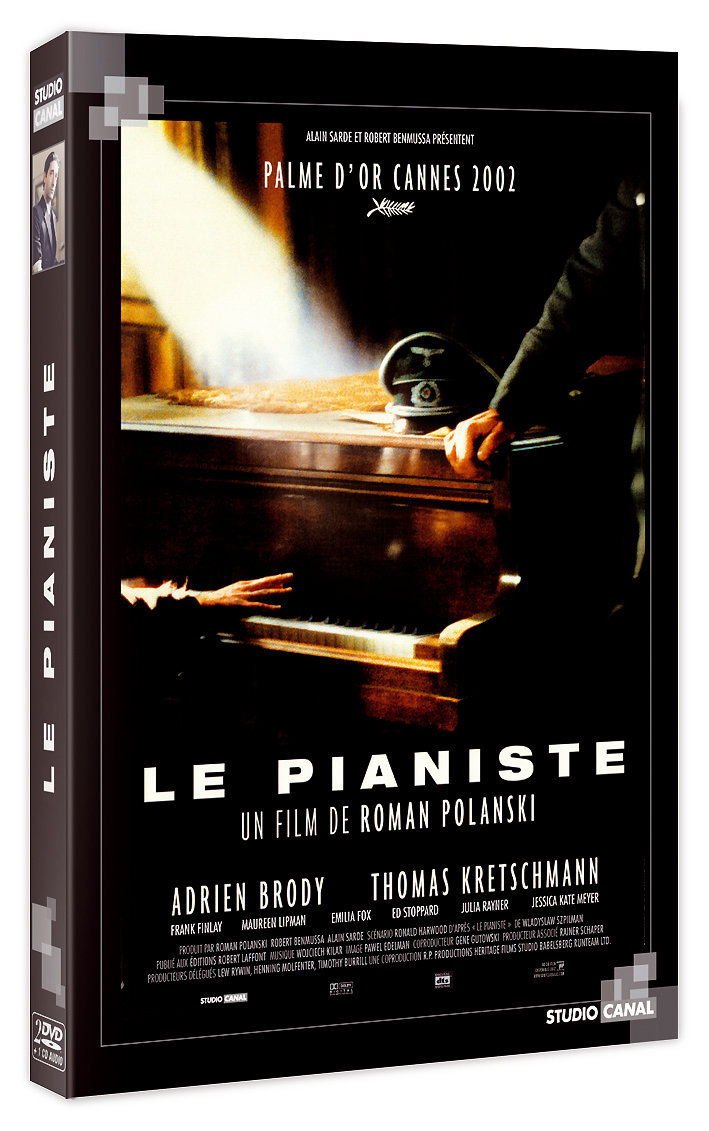ALLAN ERWAN BERGER Attendu que cette semaine fut particulièrement fertiles en repas, banquets, rassemblements familiaux et chasse au cadeau, je n’ai pas eu la possibilité d’écrire à propos de la petite affaire dans laquelle je me suis embarqué ici, sur les Sept. Tout au plus ai-je enfin trouvé le temps de pondre une note de lecture sur l’ouvrage d’une camarade, ouvrage que je vous recommande avec de vibrants trémolos, pour diverses raisons exposées (ou suggérées, PJCA ?) dans un billet posté sur le webzine Écrire-Lire-Penser.
Par conséquent, pour honorer le contrat passé avec les Sept, qui me plie à devoir produire un texte par semaine, voici, tiré de mon cœur et des catacombes de mes fichiers, un billet sur le père de mes meilleurs amis d’enfance, un plasticien nommé François Bouché, dont voici le portrait fait à Marseille en 1985 par Michel Guiguen (source : wikimedia commons).

LA SOLITUDE
La solitude est une affaire de fierté ; l’être humain se laisse avec orgueil enterrer dans sa propre odeur. Le problème du vrai poète est toujours le même : s’il est heureux pendant une longue période, il devient ordinaire ; s’il est malheureux pendant une longue période, il ne peut plus trouver en lui la force de tenir en vie sa poésie… (Orhan Pamuk : Neige, Gallimard 2005).
C’est une terrible question d’équilibre, qu’un rien peut bousculer. Ainsi le visage des poètes n’est jamais simple. C’est un grand champ de bataille… Et encore cet extérieur-là ne livre-t-il pas tout de ce qui se passe dans la poitrine et dans le ventre. Dedans, c’est la guerre entre ce qu’on aimerait faire et ce qu’on peut faire. Alors souvent, la figure du poète est double : un côté qui sourit, un côté qui fait la gueule. Artiste à l’affût, on est toujours enterré au plus sombre de soi-même, et jusque dans les assemblées, on écoute d’abord son propre silence pour y détecter ce qui y pénètre ; on n’interagit qu’à moitié avec les autres. Les poètes ne sont jamais franchement présents.
Dans cette photographie de François Bouché, sculpteur, dessinateur, râleur et peintre, je vois que même dans un instant de détente, où apparemment il est au milieu de gens qui discutent, il reste au travail. Et si le sourire et la bienveillance sont affichées du côté d’où parle un voisin de table, l’autre bord (regardez ses yeux) tire une tronche amère : ces jours-ci, la pêche est trop maigre au goût du bonhomme. Or, le temps passe.
Il n’est donné qu’à de très rares personnes d’être une source d’abondance ; peut-être même n’existent-elles que dans la légende. Qui sait à quelle puissance montait la chaudière de Dali, ou celle de Picasso, pour offrir cette possibilité de pondre autant de choses, et qui peut dire à quels tarifs Dali ou Picasso étaient soumis pour avoir le droit de mettre en pression de pareilles machines ? La plupart du temps, on est chercheur d’or simplement, avec de la boue jusqu’aux coudes, et tellement peu dans la poche que si l’on continue c’est bien parce qu’on brûle pour son art d’un amour sauvage, qui exige tout et ne récompense pour ainsi dire jamais de manière éclatante. Voilà le fouilleur de vent et ses rêves, et son obstination, et son indéracinable fidélité. Voici l’artiste, funambule qui vacille sur sa vie crue de happe-fantôme, lui-même carburant de sa passion. Cependant, le jeu en vaut tellement la peine…
Il marche dans l’abîme et a la silhouette du vent
Quelque part en Provence, au bord de la mer. Poussière blanche et rousse de la carrière au fond de la crique. Voici l’atelier du sculpteur. Quand on rentre dans son silence après la chaleur plombée du dehors nous étreint l’impératif d’un recueillement d’église, tant est douce et sereine l’odeur des argiles qui sèchent sur les étagères. Le sol est recouvert d’une poudre qui étouffe le son des pas. L’ombre est fraîche et tendre.
Des objets extraordinaires ou insolites somnolent dans les coins, baignés d’une vague odeur de thérébenthine sortant de boîtes de conserves. Au milieu de la salle, sous la verrière, gicle une structure incompréhensible assiégée d’échafaudages, hérissée de protubérances qui forment un ensemble que je ne peux relier à quoi que ce soit de ma connaissance. C’est Nostradamus, et je crois qu’il y a des méridiennes, des crans, des lignes que je trouve un peu trop raides ; on m’explique que c’est la science artisanale, les études nocturnes, et je trouve que c’est vraiment très, très vrai.
Objet véritablement mystérieux, aussi impressionnant qu’une apparition. Plus tard, cette chose eut l’honneur de traverser la Provence en hélicoptère… Dans mon souvenir, je ne sais plus s’il s’agit de la version 1 ou de la version 2 de 1976, la 1 en hélico sur les photos et la 2 dans l’atelier mais je suis encore plus épaté de constater qu’après l’accident qui a pulvérisé la première statue à peine mise en place, personne ne se décourage, ni le sculpteur ni la ville de Salon qui lui avait commandé ce Nostradamus malchanceux. Tout le monde s’obstine et remet le couvert. Ça n’a pas dû être drôle mais le résultat est là : une seconde statue naît du cerveau de Bouché. Bel exemple qui m’aura servi plus tard, lorsque des éléments se sont désagrégés au cours d’un projet. Ce qui n’est pas douteux, c’est, dès cette époque, la découverte de l’extrême puissance de l’art, et de sa portée. Et encore, ce qui est charmant : l’impossibilité d’en prophétiser les trajectoires.

Adonis : Il n’a pas d’ancêtres et ses racines sont dans ses pas. C’est parfaitement vrai, en ceci que le poète naît inopinément et n’est pas maître de son chemin. Mais c’est aussi un peu faux, car on ne part jamais de rien : de Watteau sortit Boucher le peintre avec un R, de Boucher sortit Fragonard ; il n’y a rien de plus simple, et au bout du compte chacun est une étoile qui n’empiète pas sur ses consœurs. Ainsi l’on passe d’une filiation au voisinage, et l’éternité dépose lentement sa couronne autour des artistes, laissant les petits enfants éberlués par la prescience de cette bénédiction.
Ces lions ne connaissent pas de crépuscule, ou alors si long… Leur patte est lancée par-dessus les siècles ; chacune s’abat sur un territoire à jamais signé. Car voici quelle est la portée de l’art : petit garçon, j’ouvrais des livres sur les Sumériens, leurs animaux de légende étalés sur les murs extraordinaires, les chasses pleines de chiens grimaçants et noueux jetés en avant des chars sur les fauves. Tout un monde m’invitait à rêver, à rentrer dedans pour de splendides excursions. Aussi lorsque, un jour quelconque, alors que rien ne le laissait prévoir, je reçus en cadeau l’image ci-dessous des mains de son créateur, le terrain était prêt, ensemencé, il n’y avait plus qu’à l’arroser. Je m’y emploie depuis.

Dans la brise tiède de la steppe broute une jument qui se tient à côté de son mâle. Lui est nerveux, racé, la queue rebroussée par le vent jusqu’entre les jambes. Le cou tendu, il hennit à l’horizon comme les chiens aboient à l’inconnu qui rôde au fond des halliers. Il est tout couvert de taches rondes, larges sur les flancs, qui vont s’amenuisant vers l’encolure et forment une sombre bordure à la crinière. Une grande mèche lui taquine le front. La jument est blanche, tranquille ; elle avance doucement le nez dans les herbes. Elle est sereine et confiante.
Voici des êtres qui, en une seule image, donnent à voir leur vie, leur odeur, leur sauvagerie. C’est une chose, cette vérité des corps et des esprits qui les animent, que je n’ai longtemps rencontrée que dans ce tableau de François. Puis dans Gauguin depuis. Et ailleurs encore, mais rarement.
Voilà ce que je voulais dire à propos de monsieur Bouché. Il a été fertile, ne serait-ce que par ce dessin qu’il m’a donné sans penser plus que ça aux conséquences. Mais l’on ne pense pas à tout.
L’agonie de François
La mort n’est pas une fin, je m’attends ailleurs, laisse-moi dormir ! C’est la dernière lettre connue de celui qui, sur son lit d’épuisement, se préparait à franchir la porte.
Puis il y avait eu le service, les discours ; et les survivants occupés à batailler avec ou contre des remontées de souvenirs. En premier lieu, les regrets, les choses qu’on aurait dû faire et qu’on n’a pas faites ; les bons moments trop vite avalés. Mais comment aurait-on su, puisqu’en vivant, on improvise à chaque pas ? Tout ceci, bien entendu, le défunt n’en avait cure. Il ouvrait présentement des mirettes larges comme des soucoupes.
Car se dressait devant lui une espèce de génie rouge aux yeux globuleux, avec des sourcils de démon japonais. Un chignon, et le visage féroce du type profondément outragé par le spectacle des petitesses humaines.
« QUELLE EST TA FLÈCHE ? hurla le phénomène…
― LA VOICI ! » rugit illico le candidat, qui tendit les bras et déversa sur l’affreux bonhomme un nuage de couleurs et de cris, une véritable bouillie qu’aucun mortel n’aurait pu analyser mais qui sembla être une réponse tout à fait recevable car, l’autre, tout de suite : « BRAVO ! » et d’une courbette : « Soyez le très bien venu… »
Du diable si j’y comprends quoi que ce soit. Mais le mort eut l’air de trouver ceci fort naturel. Tout guilleret, il salua poliment le génie au passage, et s’en fut déguster au large ses retrouvailles avec lui-même.
C’était, en bord de mer, une plage bruissante d’écume avec, à peu de distance, une petite île qui tendait le cou au-dessus des vagues. Un soleil bas dorait la crête des rouleaux. Des ombres, un peu violettes, dansaient au pied des herbes semées dans la dune. En se retournant, le mort vit une prairie ; des rafales y galopaient, y creusaient des nids. On aurait dit des chevaux libres remplis d’allégresse. Au loin apparaissaient des collines et, par derrière, de puissantes montagnes toutes glorieuses de neige faisaient par là-dessus un barrage aux étoiles.
François se creusa un nid dans le sable. Là, heureux et placide comme un oursin dans son trou, il regarda au ciel passer les nuages, prodigieux bestiaires. Des formes tentaculaires, qu’une bourrasque d’altitude ébouriffait, faisaient songer aux poulpes, aux étoiles de mer. Il vit, vaste dirigeable, dériver le roi des harengs, qui ondule à la surface des rêves des marins… Cela lui redonna l’envie de créer. De son vivant, il avait été un sculpteur fécond, parfois heureux, mais trop souvent frustré car la création, chez les mortels, est douloureuse. Dans ces moments-là, il tournait et virait dans son atelier, allant jusqu’à se mordre le poing devant un désir qu’il ne pouvait attraper.
Les ébauches des projets en cours, ou les maquettes d’œuvres réussies qui l’épiaient du haut des étagères, n’avaient jamais réussi à le consoler. Car tout, absolument tout, est toujours remis en cause à chaque nouvel accouchement. Et d’abord : a-t-on toujours du talent ? Où est-il passé ? Suis-je condamné aujourd’hui encore à pelleter de la merde jusqu’à ce soir, jusqu’à la fin de la semaine ? Tandis que ma vie s’enfuit…
Mais ici, au bord de la mer, il sentit se lever en lui la rouge aurore, la puissance du potier. Bientôt, elle fut déployée tout entière, un désir vaste jusqu’au vertige. Une fleur qui aurait eu la taille de millions de soleils. Puis il crut saisir qu’il était lui-même cette fleur. Dans ses mains, comme du sable, roulaient des mondes et leurs multitudes ; lui se baignait dans l’univers comme un âne béat se vautre dans la poussière du chemin.
Il en avait des fourmillements aux bouts des doigts. C’était bon ! Alors, il se leva, ivre, et s’avança vers les vagues ; il plongea dans la mer tiède. Il fit le phoque, il fit des galipettes, il fit des bulles, des bruits de trompette. Il ébroua sa crinière de vieux lion argenté, et des milliers de perles étincelèrent en le nimbant. Il regarda ses mains toutes scintillantes, et à travers ses doigts écartés, crevassés par une vie de travail sur la glaise, il vit le paysage : la campagne, les collines, et la barrière des grandes montagnes au-dessus de laquelle on voyait sautiller les petites étoiles qui voulaient savoir, nom d’un père Noël, ce que c’était que ce dieu qui venait tout juste de naître.
Regardez, le voici qui vient. Il s’est enfoncé dans la campagne. Il a marché dans une savane ; à la fin de la journée, dans les rougeurs du couchant, au pied des collines, il a trouvé une bonne terre, et un point d’eau que des bêtes piétinent, pour l’instant invisibles. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de traces, mais lui les voit, et c’est là toute la différence.
Car maintenant qu’il peut, sans retenue, il ne va pas se priver ! Il écarte les mains, il prend une grosse brassée de terre collante qu’il serre contre sa poitrine, et puis il s’avance vers une pierre bien plate.
Des nuées de bêtes sortiront de ses flancs !
Il chante une histoire qu’il invente pour son premier animal : un grillon très courageux. Elle n’a l’air de rien cette histoire, juste quatre mots, mais attendez de le voir, son grillon…
Et le soleil s’endort sur cette bonne résolution.
Passez de bonnes fêtes, tâchez d’être fertiles et utiles.